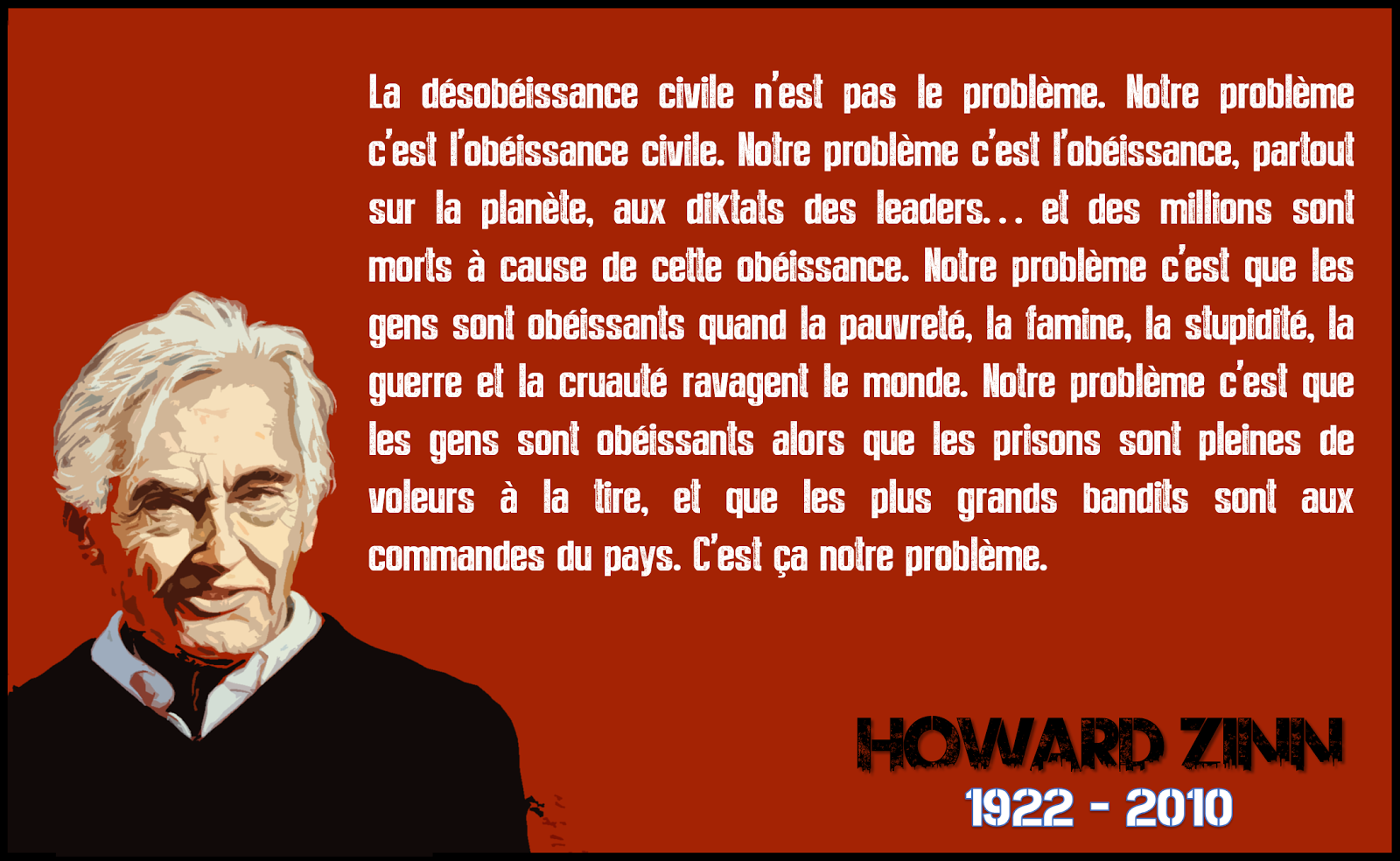Nous reproduisons ici un extrait de l'excellent livre "L'Etat" que Bernard Charbonneau acheva d'écrire en 1948. Il y décrit la plongée de la majeure partie de l'humanité, au fil des siècles et proportionnellement à la progression de l'Etat, dans un monde totalitaire. Nous considérons que la volonté de puissance donnant naissance à l'Etat s'inscrit dans le cadre plus vaste du processus de civilisation.
Voici le passage où nous sommes passés et où nous vivons encore : celui de la « Révolution du XXe siècle » ; celle qui nous fait pénétrer dans cet avenir que désigne si bien le qualificatif de totalitaire. J’emploie ce terme parce qu’il me paraît englober et préciser à la fois toutes les caractéristiques de ce grand changement. Je dis état totalitaire, et non état fasciste ou soviétique, parce que cet adjectif me paraît désigner l’essentiel : non des systèmes d’idées qui ne servent qu’à justifier après coup le fait accompli, mais le fait lui-même : à la fois l’esprit et la réalité sensible. Sur ce plan qui est celui où l’homme vit tous les jours, — dans la rue, dans la queue du guichet ou derrière les barbelés du camp — les régimes totalitaires sont identiques. Non pas malgré la violence, mais par la violence de leur lutte, car le combat qui se substitue à la volonté de justice ou de liberté pour porter dans tous les camps le même fruit.
Ce monde est totalitaire. Partout la même obsession de vaincre rassemble toutes les forces dans un pouvoir central servi par un parti, et cette centralisation sera partout mensongère, dissimulée par son contraire : un décor fédéraliste ou régional. Partout, se justifiant d’un bien absolu, et par l’ennemi intérieur et extérieur, une agressivité à base de peur mène la guerre à tout ce qui prétend exister par soi-même : à l’individu, au groupe, aux peuples voisins. Servie par une technique concentrée et proliférante, une volonté qui s’étend avec elle à tout, et qui elle aussi ne connaît d’autres bornes que celles des possibilités pratiques. Partout le chef et le parti, l’insigne et le slogan, la bureaucratie et la masse, la propagande. Partout les mythes qui exaltent une civilisation mécanisée : la Production, le Travail. Et ceux par lesquels l’homme se dissimule le prix qu’il doit la payer : le héros, l’aventure. Partout la même civilisation, — jusque dans le moindre détail, car il s’agit d’une identité concrète […] — jusqu’à la même cravate sombre sur la même chemise blanche. Le regard peut saisir du premier coup d’œil tout ce que ces régimes ont d’identique, mais ce qu’ils ont de différent échappe aux yeux : à peine une inflexion du bras, une idée … Si les doctrines, et les troupes, s’opposent, l’image de l’avenir, — cette vie que tous distinguent dans leurs rêves et que les propagandes s’efforcent de fixer —, est bien partout la même. Le même autostrade asphalté court à travers les mêmes jardins, sous les mêmes ciels nuageux les mêmes barrages se dressent ; la même fille blonde aux dents intactes et aux yeux vides.
Il est vrai que les partisans de ces divers régimes ont un bon moyen pour nier l’identité qui les confond. Lorsque vous leur montrez la similitude des mots d’ordre, ils invoquent la disparité des faits (par exemple, selon les communistes, les hitlériens peuvent user de slogans socialistes — en fait, par leur clientèle, ils ne sont pas socialistes). Mais si vous signalez l’identité des faits (par exemples, la police politique en Russie soviétique et dans le IIIème Reich), ils invoqueront alors la disparité des fins que ces mêmes moyens servent. Ils peuvent ainsi échapper indéfiniment.
Ce qui distingue au départ les différents régimes totalitaires est secondaire par rapport à ce qui les rend de plus en plus semblables, — mais nous ne songeons même pas à comparer, car ce qui les rend semblables, c’est ce que nous ne discutons même plus.
Non seulement les régimes fascistes et stalinien rentrent dans cette description, mais aussi les démocraties plus ou moins engagées dans la voie totalitaire ; elles dessinent toute une variété d’ébauches plus ou moins perfectionnées dont le régime hitlérien donne une image achevée. Pourquoi parler d’hitlérisme ou de communisme, ou peut-être même de travaillisme ? La perversion totalitaire n’est pas dans tel de nos ennemis, mais dans le monde où nous vivons. Il ne s’agit pas d’un concept politique propre à telle fraction de l’humanité moderne, mais d’un mal déterminé par des structures économiques et sociales qui lui sont communes, qui l’infectent à un niveau si profond que ses membres en sont à peine conscients : les responsables des tyrannies totalitaires sont des dupes plus que des criminels. Aussi nulle société actuelle ne peut se prétendre intacte, les Français en particulier se font des illusions lorsqu’ils affirment qu’un tel régime ne pourra jamais s’établir dans leur pays. Le totalitarisme n’est pas un concept, mais une infection qui pullulera aussi bien sur le conservatisme de droite que sur la révolution de gauche ; seulement, sur le premier terrain elle produira des formes fascistes et sur le second des formes communistes. La maladie est la même, bien que les cas soient différents. La politisation totalitaire sera brutale et fanatique chez des peuples vigoureux comme en Allemagne et en Russie, à la fois cocardière et corrompue dans de vieux pays comme l’Italie et la France modérée, mais stricte dans des sociétés moralisées comme l’Angleterre. Ce mal n’est pas un abcès affectant tel point de l’espace, mais l’infection généralisée de cet organisme de plus en plus solidaire qui a nom espèce humaine. Aussi, elle nous apparaît comme se manifestant parallèlement partout à la fois. En réalité elle est une ; comme est un notre monde et l’effort qui le dominera en bloc. […]
Pour lire d’autres extraits du livre l’Etat, de Bernard Charbonneau, cliquez sur l’image ci-dessus!
Fascismes et communisme semblent surgir dans une convulsion qui déchire l’ancien ordre social ; par le sang répandu, l’éclat des principes et des héros, ils se placent d’emblée sur le plan de la tragédie, et ils s’y placent volontairement, car ils vivent des passions. Il n’y a donc pas à s’étonner si les partisans et les adversaires des mouvements totalitaires les considèrent avant tout comme une rupture avec le passé : une révolution, qu’elle soit odieuse ou libératrice. En douter serait aujourd’hui pour la plupart des hommes douter du sens même de la vie, car leur vie n’a de sens que par ce drame. Le piège du mai sera toujours double : avant, de nous apparaître comme une perversion étrangère à notre entendement, après, de s’imposer à nous comme la plus normale des choses. La tentation de l’esprit en face de la menace totalitaire ? qu’elle nous semble trop loin (en 1913 ou en 1928, peut-être même en 1948), car il n’y a rien d’aussi rare que l’imagination du réel… avant d’être si près (en 1940 ou en 1945 par exemple) qu’elle semble aller de soi. Si le mal familier d’hier nous avait paru moins normal, peut-être que la monstruosité d’aujourd’hui nous paraîtrait moins familière.
Au contraire, je crois pouvoir affirmer ici qu’il n’y a pas de discontinuité entre l’ère libérale et celle des tyrannies. Un mouvement aussi spontané et aussi général n’a pas surgi ex-nihilo des temps qui l’ont précédé. Le seul fait qu’ils se soient succédés prouve que le monde libéral a été le terrain sur lequel s’est développé le mouvement totalitaire ; le XXe siècle est l’héritier du XIXe. Ce qui aurait dû surprendre, ce n’est pas la conclusion inéluctable, mais l’incapacité des hommes à voir le sens de leur présent.
La contrainte totalitaire s’est développée à l’intérieur même de la société libérale. Certes, ce ne fut pas sur le plan des principes, mais sur celui des techniques et des mythes qui constituent la vie de tous les jours du commun des mortels. D’une part dans les moyens : l’administration, l’armée, la machine, le style de vie et les formes sociales qu’ils conditionnent. De l’autre dans les réactions anarchiques qu’ils provoquent chez un être humain travaillé par ces forces qu’il ne sait pas maîtriser : une mentalité collective qui, comme ces techniques, dépasse infiniment les limites d’une classe parce qu’elle est l’expression d’une réaction humaine à des conditions communes à presque toutes les classes. Le plus directement saisissable de la vie et de l’esprit de la civilisation moderne : voilà ce commun dénominateur que révèle brusquement la « révolution » totalitaire.
Elle n’a qu’une origine : sous le régime des droits de l’homme la civilisation de la masse, de la machine et de l’Etat. Analyser les causes, et souvent les formes, du régime totalitaire reviendrait à la décrire ; il ne saurait être question d’aller jusqu’au bout de cette analyse, car il ne s’agit pas de définir quelques principes, mais de peindre l’infini des travaux et des jours d’une vie : la nôtre.
Pourquoi les principes de liberté les plus purs ont-ils abouti aux tyrannies les plus complètes de l’histoire ? Parce que la liberté des libéraux n’a pas été l’esprit vivant qui aurait pu former le monde moderne, mais la formule qui a servi à exorciser la seule force qui pouvait s’imposer à lui. Réduisant la liberté à la liberté de pensée, le libéralisme a déchaîné à travers l’idolâtrie du bonheur individuel une passion de l’utile et de la puissance collective qui elle a vraiment façonné le monde actuel.
Cette liberté n’était pas une vérité sacrée ; elle n’était pas le devoir que l’homme doit accomplir contre le monde et contre lui-même, le plus terrible de tous : le choix dans la solitude, mais une commodité que pouvait garantir la loi : l’esprit critique, la liberté… de pensée. Ce que l’individu libéral appelait liberté, ce n’était plus une passion conquérante s’exprimant par l’action, mais une délectation passive, purement intérieure, que la contrainte de l’Etat lui paraissait devoir protéger des heurts avec le monde extérieur. Alors, la liberté a cessé d’être le commandement qui s’impose aux conditions par les personnes ; à travers les hommes elle a cessé de former la réalité à son image. Comme toute pensée qui dégénère, la liberté des libéraux est devenue un idéalisme. Définissant la liberté de l’individu en dehors de toute condition concrète, sauf l’unité — et à ce compte il y aura toujours des individus libres —, le libéralisme la laisse écraser par les conditions — non seulement par les conditions économiques, mais par toutes les autres. Par cette somme de toutes les déterminations qui a nom Etat moderne.
Le réalisme de la tyrannie totalitaire est la conclusion nécessaire de l’idéalisme libéral. Si la liberté n’est pas une vérité sacrée et si elle ne commande pas au réel, tout est permis : dans leur inexistence tous les principes se valent et ils n’ont rien à voir avec l’action qui est du seul domaine des techniques. Et voici opposés la valeur à la réalité, l’esprit à la pratique ; et voici commencée cette querelle du« dégagement » et de « l’engagement » caractéristique d’une société fascistisée qui a complètement oublié que penser c’est vivre et qu’adorer c’est obéir. La liberté des libéraux annonce le nihilisme spirituel et justifie le fanatisme pratique des régimes totalitaires.
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais si rien en ce bas-monde n’est à Dieu, au nom de quoi rejeter les prétentions de César ? Au nom de quoi imposer des bornes aux évidences de l’organisation matérielle ? Pourquoi n’ordonnerait-elle pas la vie et la mort elles-mêmes ? Le droit pour les parents d’élever leurs enfants selon leur vérité, le droit pour l’individu de choisir son métier et de vivre dans le pays qu’il a élu, ne peuvent être que par la foi dans une orthodoxie qui attribue aux personnes une valeur suprême : l’avance de l’Etat mesure exactement le recul de cette foi. La vérité ne fixe pas seulement une direction à l’Etat, elle lui fixe les limites de son domaine. Car son émancipation et son expansion totale ne sont que les deux aspects d’un même phénomène. Si une civilisation n’a pas de principe vécu, rien ne peut y arrêter la prolifération de l’Etat. En opposant la liberté à la Vérité et en la chassant du monde, le XIXe siècle n’a délivré l’individu de l’autorité des Eglises que pour le livrer à la pire des tyrannies : à celle de la force qui n’a pas d’autres normes qu’elle-même ; au poids de la nécessité.
Le même rapport direct unit l’individualisme libéral aux disciplines massives de l’Etat totalitaire. De même que le libéralisme oppose — exactement comme l’Etat totalitaire — l’esprit à la réalité et la liberté à la vérité, il oppose exactement comme l’Etat totalitaire — l’individu à la société ; et il les détruit ainsi pour deux. Comme l’individu libéral n’a rien en propre, il n’existe qu’en s’opposant aux autres : par ses intérêts, par sa critique individuelle. Il n’a pas assez d’existence personnelle pour s’élever sans disparaitre jusqu’à un intérêt et une vérité communes ; dans cette situation l’individu ne peut être que ce qui détruit l’ordre et l’ordre ce qui détruit l’individu. Lorsque la société individualiste n’est pas un pur concept, elle n’est qu’un pandémonium d’opinions et d’appétits individuels. Un tel désordre est évidemment impossible ; d’autant plus que si l’individu libéral est déjà isolé, le vieil être social subsiste suffisamment en lui pour lui rendre cet isolement pesant. Alors le désir de l’ordre dans la rue s’ajoute à la nostalgie d’une communauté pour pousser au rétablissement d’une discipline sociale.
Or l’individu ne peut plus la concevoir qu’en termes de contraintes politiques. Tout en vivant de ce qui en subsiste, le libéralisme discrédite et détruit la société spontanée ; et il n’a rien fait pour former dans l’individu la personne capable d’élever sa liberté au rang de principe social : celui-ci n’est pas plus capable de concevoir que d’exercer une loi qui naisse directement de lui-même. Cette masse d’atomes isolés appelle d’implacables disciplines d’Etat […] ; quant à l’individu moyen prêt à céder à tout ce qui menace son confort individuel, il est l’élément indispensable aux entreprises les plus abstraites de la dictature. Si le désordre individualiste appelle l’Etat totalitaire, l’Etat totalitaire suppose l’individu.
La liberté individuelle a-t-elle été vraiment le principe de la société libérale ? A voir les faits on pourrait se demander si cette affirmation formelle de l’autonomie individuelle n’a pas eu pour fonction de justifier auprès des hommes une évolution qui tendait à la détruire.
Le libéralisme a cru que le progrès de la liberté était lié à la volonté d’un bonheur qu’il ramenait à l’amélioration des conditions matérielles par le progrès technique. Mais un bonheur réduit au bien-être n’est pas une force de liberté ; le luxe a corrompu l’aristocratie des républiques antiques, le confort autant que la misère risque de corrompre les masses de la démocratie moderne. Le souci exclusif de leur bien-être enferme les individus dans un égoïsme qui livre les affaires publiques à une minorité d’ambitieux. L’obsession des intérêts matériels, voici la perte de la démocratie et l’état d’esprit que cultive la dictature. Le culte bourgeois du confort et de l’argent a préparé les masses à accepter l’Etat totalitaire.
Pour approfondir et lire un article sur la culture du bien-être et du narcissisme, cliquez sur l’image.
La liberté est en contradiction avec le bonheur. La liberté authentique n’est pas satisfaction, mais risque, effort et non jouissance ; à l’extrême elle est l’angoisse de celui qui tient entre ses mains son salut et sa perte : la moins confortable des situations. Celui qui veut avant tout le bonheur doit sacrifier avant tout sa liberté, car la servitude le décharge du plus lourd des fardeaux : sa responsabilité ; — le conformisme est la première condition du confort. Le libéralisme répète à l’individu qu’être libre, c’est être heureux ; comme toute servitude apporte un semblant de paix, il finira par croire qu’être serf c’est être libre.
Si la liberté est parfois favorable à une amélioration du standard de vie, par contre elle est en contradiction absolue avec une condition fondamentale du bonheur : la sécurité. C’est cette notion mortelle à la liberté qui va envahir la démocratie moderne et justifier l’Etat. Car si la civilisation libérale a amélioré les conditions d’existence, malgré la multiplication des assurances elle n’a pas apporté la sécurité. L’individu moderne vit sous la menace constante d’être dépouillé par les crises ou les guerres. Mais peut- être plus que l’insécurité matérielle, l’insécurité morale le ronge ; malgré le mur que construisent devant l’homme des divertissements toujours plus perfectionnés, le libéralisme le laisse devant l’angoisse fondamentale de la liberté sans le préparer à l’assumer. Aussi la volonté d’être heureux mène les individus à rechercher, autant que la contrainte qui les dispensera du choix, l’orthodoxie qui les déchargera de penser. Assoiffé d’explications finales autant que de disciplines, l’individu libéral est prêt à accepter le régime qui se donnera pour but de sacrifier toute sa liberté à tout son bonheur.
Pour être total le bonheur ne doit pas se réduire à une simple amélioration du confort individuel, il doit devenir un mythe qui synthétise l’égoïsme et la peur de la solitude. Il n’est plus dans des satisfactions objectives qui laisseraient planer au-dessus d’elles la menace de l’inquiétude, il est dans l’action : dans le perpétuel développement des conditions collectives. En attendant un bien-être qu’il situe dans l’avenir, l’individu trouve son équilibre dans l’accomplissement de sa tâche à l’intérieur du corps social ; il sert, et la société l’honore et le paye parce qu’il sert. La morale, et plus spécialement la morale professionnelle façonne à l’intérieur des sociétés capitalistes le rouage des régimes totalitaires : l’homme défini par sa fonction.
Autant que le bonheur individuel l’utilité collective est le principe des sociétés libérales. Mais entre la liberté et l’utile la contradiction est cette fois absolue : la liberté ne sert pas, elle est libre. Une liberté subordonnée peut aider à une amélioration du rendement, elle dépendra avant tout du plan et de l’obéissance au plan ; du point de vue de l’efficacité la liberté ne peut être qu’une source de trouble, une perte d’énergie. En définissant le progrès par le développement matériel la société bourgeoise a préparé l’humanité à admettre la contrainte totalitaire. Le capitalisme libéral a entreprit, dans le domaine économique et social, une immense mobilisation des énergies dont les « plans » totalitaires ne sont que l’aboutissement politique : trop souvent, ce que nous prenons pour l’esprit de liberté, c’est le refus de mobiliser prématurément au nom d’une orthodoxie politique ce qui le sera plus tard au nom du rendement.
C’est dans l’économie libérale que s’est élaboré le plus efficacement le monde totalitaire. Dès le début du XIXe siècle, la centralisation politique s’est renforcée d’une organisation économique qui tendait à concentrer la puissance en un seul point d’où dépendait tout le reste. Ainsi s’est formée une humanité habituée à subir, et à subir sans comprendre, pour laquelle le mot de liberté s’est vidé progressivement de tout contenu. Si nous considérons la tendance de la technique actuelle à réserver la connaissance à une minorité de spécialistes comme elle réserve la puissance à quelques patrons ou directeurs, sa tendance à s’étendre méthodiquement à tout, sans autre principe que celui de l’efficacité pratique, alors nous pouvons bien affirmer qu’en dehors de toute volonté politique consciente le monde libéral tendait bien à devenir un monde totalitaire, où la démocratie sociale devenait aussi absurde que la démocratie politique.
La démocratie tend au partage de la vérité et de la puissance entre tous les citoyens, la technique tend au monopole de la vérité autant qu’à celui du pouvoir. Nous payons chaque perfectionnement d’une complication et d’une contrainte, — le tout est de savoir si ce perfectionnement vaut ce prix. Comme le rouage s’ajoute au rouage, l’explication s’ajoute à l’explication, et dans la mesure où l’organisation englobe de nouveaux domaines, elle multiplie les interférences. Ainsi, le sens commun à tous les hommes ne suffit plus, l’individu ne peut plus réaliser la condition de base de toute démocratie : une connaissance élémentaire de ses intérêts matériels, car ceux- ci dépendent d’une foule d’éléments qu’il ne peut plus atteindre directement. Pour juger sérieusement de son salaire, il lui faut désormais connaitre le mécanisme de la monnaie, le système fiscal, l’économie française et sa situation dans l’économie européenne : une culture politique et juridique du niveau de la licence en droit. Dans ces conditions le citoyen ordinaire n’essaye même plus de comprendre, il se jette sur l’explication qui lui prépare la propagande ; atrophiant son aptitude à s’expliquer, la complexité du monde actuel le livre au simplisme du slogan. Plus les techniques deviennent hermétiques et rigoureuses, plus leur vulgarisation devient vulgaire : l’image ou l’incantation qui s’adresse aux nerfs de la foule compense la formule mathématique qui s’adresse à l’intellect du technicien.
Submergé par la multiplicité des faits où l’économie complique la politique et la politique l’économie, l’individu se détourne d’un pouvoir qui n’a plus de sens pour lui ; sa condition étant d’être dépassé, sa réaction est de s’abandonner. Dans la nation, dans l’armée, dans le parti, et dans un syndicalisme bureaucratisé, il n’est plus qu’un rouage habitué à subir l’impulsion d’un état-major d’administrateurs. Le sens commun, — et son représentant le Parlement — n’a plus d’autorité ; dans une société technicisée, ce sont les bureaux qui gouvernent. Le Parlement n’est que le mensonge (poussé à l’extrême dans le cas des Parlements hitlérien et soviétique) qui permet aux hommes d’esquiver le problème posé par la fin du bon sens.
Partout où pénètre la technique recule la liberté, car à la différence de la pensée libérale, ses vérités sont sans appel et leur exécution automatique. La technique comme la loi impose à tous la même discipline, et partout où elle s’établit, s’établit la loi qui peut seule rendre ses applications possibles : la discipline totalitaire dans ce qu’elle a d’apparemment légitime ne fait qu’exprimer en clair la discipline industrielle. Ainsi sous le couvert du libéralisme, l’évolution économique réalise dans la vie quotidienne des individus la condition fondamentale du régime totalitaire : la démission de l’homme, qu’il s’agisse de l’indifférence atone du plus grand nombre à des déterminations qui les dépassent, ou de la participation frénétique de quelques-uns.
La civilisation libérale réalise le fondement social de tout régime totalitaire : la masse prolétarisée. L’ère libérale glorifie l’individu ; mais l’individu moderne n’est seul que dans l’isoloir, partout ailleurs : au régiment, à l’usine et dans la ville, il est pris dans la masse comme une goutte d’eau dans la mer. La concentration industrielle accumule les multitudes et le pouvoir niveleur de la technique façonne l’élément de la masse indifférenciée : l’individu, que rien ne distingue de l’individu, ni une forme, ni une pensée, ni un pouvoir propres. La société libérale a reconnu aux individus leur droit au vote, mais n’a pas reconnu leur droit à l’existence. Par le capitalisme elle a dépossédé la plupart des hommes de la propriété de leurs outils, par la guerre elle les a dépossédés de leurs corps, par la presse et la propagande de leur esprit même. Qu’il porte le bleu de l’ouvrier ou le veston râpé du retraité, l’individu moderne est un être auquel rien n’appartient personnellement, pas plus la terre que la vérité. Il n’y a plus d’hommes, mais ce poids inerte qui croule soudain : les masses des villes, les masses de la guerre, en attendant les masses des manifestations totalitaires. Force aveugle, la masse fonce dans l’histoire, — mais elle ne dévalera jamais que plus bas.
Que la prolétarisation des classes moyennes aboutisse au fascisme, et celle de la classe ouvrière au communisme, le même désespoir engendre la même démence : l’impuissance individuelle mène au culte de la puissance collective. Quand l’individu se tourne vers lui-même, il ne trouve qu’incertitude, vide et débilité ; mais quand il considère le monde qui le domine il voit triompher la force. Tout le dissuade de chercher l’autorité autant que le pouvoir en lui-même pour le tourner vers la puissance collective. Tandis que se dressent toujours plus haut des buildings, dans la fissure de la rue passe l’individu, perdu dans la foule, mais suivi par les contraintes de l’argent et de la loi comme par son ombre ; et sur lui s’effondrent guerres et révolutions qu’il ne peut que suivre. Alors, écrasé, il compense ses complexes d’infériorité individuelle par ses complexes de supériorité collective : celle de sa nation, de son parti ou de sa classe. La révolte de l’individu alimente ainsi les forces qui l’anéantissent.
C’est enfin, comme nous n’avons pas cessé de le voir, le développement de l’Etat qui a conduit à l’Etat totalitaire ; il ne fait que conclure une évolution qui tendait à substituer partout la loi à la nature et à l’initiative individuelle. Les démocraties modernes ont prétendu libérer l’individu de l’arbitraire du Prince ; mais à leur insu une force irrésistible les poussait à étendre le champ de son activité. La nature est imparfaite, et bien plus encore l’homme ; tandis que l’initiative individuelle, au prix des plus grands efforts, n’aboutit qu’à des résultats fragmentaires qui choquent l’esprit d’efficacité autant que la raison, la loi, du premier coup, obtient un résultat universel. […] Les médecins exigeront de l’Etat qu’il impose l’hygiène et les moralistes la vertu ; avec chaque catégorie sociale chaque règne apportera sa pierre à l’édifice, au hasard de ses préjugés. […] La loi ne se contente plus de sanctionner quelques crimes, c’est la masse des individus qu’elle contraint au bien dans leurs actes les plus quotidiens. La contrainte proliférante de la loi détruit la démocratie de l’intérieur, apportant le Bien aux hommes tout en atrophiant leur faculté à le faire. Et quelle perfection vaudrait de lui sacrifier la capacité de poursuivre ?
Les facilités de la loi font oublier que, quelle que soit son origine, elle est en contradiction avec la liberté : son principe est l’obligation. Ce qu’elle définit, il est désormais interdit à l’homme de l’inventer ; ce qu’elle ordonne, il lui est interdit de le choisir. Peu à peu l’individu perd le sens de l’initiative et prend l’habitude d’attendre l’impulsion de la loi. S’il lui reste quelque esprit d’indépendance, il le dépense à critiquer l’inertie des pouvoirs publics. Veut-il ouvrir une école, fonder un orchestre, il demandera la subvention et l’autorisation de l’Etat ; — d’ailleurs comment pourrait-il faire autrement ? S’il n’y avait pas d’Etat, il n’y aurait, semble-t-il, ni travaux publics ni charité. L’action sur et par l’Etat résume en elle toutes les formes de l’action, la liberté de voter pour les partis toutes les libertés concrètes.
L’individu moderne perd le sens de l’être ; il ne s’intéresse plus au sujet, mais à l’objet. L’Etat lui paraît le moyen d’obtenir aux moindres frais ce résultat objectif- Pourquoi alors ne pas étendre à tout cette méthode ? Si par aliénation nous entendons le fait d’être à la fois dépossède et possédé. — d’abdiquer sa vie entre les mains d’un autre qui vous la vole pour l’en recevoir —, alors l’histoire actuelle n’est qu’un irrésistible processus d’aliénation où l’individu moderne transfère sa pensée et son action à l’Etat. A la fin seuls existent les Sports, les Beaux-Arts, la Propagande ; l’être humain n’est plus qu’une survivance encombrante dans l’énorme appareil dont il fut le prétexte. L’Etat totalitaire n’est pas autre chose qu’une concrétisation de la démission totale de l’homme.
Le sens de la vie individuelle étant défini par des conditions extérieures, et l’individu existant de moins en moins par lui-même, les tâches de l’Etat s’avèrent illimitées. Le Bien s’identifiant à l’utile et à la puissance, l’intensité de la vie se confond avec celle de la bataille politique : l’Etat succède à l’homme. A l’origine du régime totalitaire toutes les formes de la politisation, et surtout le fait que les individus ne s’interrogent même plus sur les problèmes qu’elle pose. […]
Cette liberté qui n’est plus dans le geste quotidien ne vit plus dans l’esprit quotidien ; elle peut survivre quelque temps dans le vocabulaire, elle n’est plus la puissance affective qui commande les mouvements des masses. Derrière la phraséologie libérale se forme spontanément une mentalité collective que l’on pourrait appeler pré-fasciste ou mieux pré-totalitaire, qui détruit la liberté de l’intérieur pour n’en laisser que des concepts vides.
Cet état d’esprit, comme la réalité qu’il traduit, n’est pas dans les articles des constitutions, mais dans la vie : dans la rue ou au comptoir ; il ne se manifeste pas dans les gros livres, mais dans les lieux communs des conversations banales. Celui qui veut la saisir l’atteindra dans la presse non-politique et dans le cinéma des pays sans propagande : dans Gringoire plutôt que dans Nietzsche et dans Ce Soir plutôt que dans Karl Marx. Toujours le plus bas possible, — encore mieux dans l’image que dans le texte. Cette mentalité n’exprime pas telle tendance, mais le monde actuel dans son ensemble. Ce n’est pas telle vague qui forme le rocher, mais l’usure de la mer ; ce n’est pas tel journal qui forme la mentalité pré-totalitaire, mais le journal, — et plus tard ce ne sera pas telle propagande, mais la Propagande qui pourra l’exploiter. Cette mentalité n’est pas celle de tel individu, elle appartient à une société : l’homme intelligent y succombera aussi bien que l’imbécile, seulement ce sera pour s’être jugé au-dessus d’elle, car ses constructions systématiques ne feront qu’organiser les lieux communs enracinés dans son subconscient. Et elle n’est pas le propre de tel parti ou de telle classe sociale ; mentalité moyenne, elle se réalise le plus parfaitement dans les classes moyennes. Cependant l’ouvrier de chez Renault et l’employé de banque, parce qu’ils vont voir les mêmes films, subiront l’empreinte des mêmes images. Ainsi en plein triomphe du libéralisme, débordant largement les limites du fascisme conscient, s’est constituée une mythologie pré-fasciste qui a été la base psychologique du fascisme dans les masses.
Bernard Charbonneau