http://www.eric-verhaeghe.fr/un-air-de-liberte-lintroduction-du-livre/
Jusqu’ici Tout Va Bien – L’introduction
Comme beaucoup d’énarques, je ne suis ni de droite ni de gauche, mais avant tout du côté de l’intérêt général. Il me semble qu’aujourd’hui celui-ci court un si grand danger que prendre la parole pour le défendre est devenu un devoir.
J’appartiens à trois cercles relativement fermés et rares dans la corporation des hauts fonctionnaires.
D’abord, je suis fils d’ouvrier. Le cercle des enfants d’ouvrier à l’ENA est très clairsemé. Mon père était maçon. J’ai grandi au pied d’une mine de charbon, en Belgique. Je dois mes études à l’Education nationale et aux bourses qu’elle offrait aux plus pauvres. Elles m’ont permis de fréquenter les écoles de mon choix, dès lors que j’ai pu prouver mes capacités à y entrer. La France que j’aime permettait ce genre d’itinéraire. A ceux qui travaillaient et qui le voulaient, elle offrait une probabilité satisfaisante de réussir.
J’ai eu de la chance: j’ai fait partie des dernières fournées où l’ascenseur social était possible. Je me revois, au printemps 1986, apporter mon dossier de candidature à l’hypokhâgne du lycée Henri-IV. Je venais de nulle part, mais je fus accepté dans ce saint des saints républicain. Un quart de siècle plus tard, la probabilité que je sois admis, pire: la probabilité que je m’autorise l’audace d’y être candidat, serait beaucoup plus faible. Depuis vingt-cinq ans, la démocratisation de l’enseignement a faibli et, à mesure que le nombre de bacheliers a augmenté, l’égalité des chances a reculé.
Que s’est-il passé pour que nous régressions collectivement? Personne ne le sait exactement, mais nous sentons tous, de façon diffuse, que la société s’est raidie sur ses fondements. Les enfants des milieux défavorisés apprennent de moins en moins bien à lire et à écrire. Ils suivent de moins en moins facilement les programmes scolaires. Leur niveau, lorsqu’ils passent le baccalauréat, est de moins en moins concurrentiel. En un mot, une inégalité scolaire grandissante les éloigne des meilleurs cursus. Ceux qui malgré tout franchissent ces caps sont ensuite sévèrement écrémés aux concours des grandes écoles, socialement plus sélectifs qu’avant, particulièrement dans les écoles de commerce qui ont introduit une nouvelle hiérarchie dans les savoirs, celle de l’argent. Comme je le dis plus loin, la ségrégation sociale est à l’oeuvre, vivace, florissante.
Et puis, il y a ce grand malheur qui s’est abattu sur notre pays depuis vingt-cinq ans: l’argent facile. Dans mon enfance, travailler garantissait une vie correcte et une réussite relative. Le travail fondait la société. Et peu à peu, cette idée-là a vécu.
D’un côté, les médias n’ont cessé de nous répéter, et ne cesse encore de le faire, que le travail en France coûtait et coûte toujours trop cher. On paye trop les salariés. Les charges sociales sont trop élevées. Baisser le coût du travail est devenu une obsession. De droite comme de gauche. J’en veux pour preuve la formidable modération salariale que la loi sur les trente-cinq heures, préparée par Martine Aubry, a permis: en échange d’une diminution du temps de travail, il a fallu accepter une longue stagnation des salaires. Que les salariés aient dû produire en trente-cinq heures ce qu’ils produisaient en trente-neuf importait peu. L’essentiel était de limiter au maximum les coûts. Comme cela ne suffisait pas, les allégements de charge ont reporté sur le contribuable un poids annuel de 30 milliards d’euros porté jusque-là par les employeurs. Ce transfert explique une très large partie de la dette publique contractée depuis 15 ans. Quand on sait que l’essentiel des impôts est acquitté par les salariés, en réalité cette opération a consisté a reporté sur ceux qui travaillent ce qui incombait auparavant à ceux qui les emploient. Tout cela concourt à une dévaluation constante du travail dans l’esprit collectif, à une sorte de réflexe pavlovien où le travail est assimilé à une charge inutile ou, au mieux, excessive.
D’un autre côté, l’argent s’est mis à pleuvoir sur une élite financière et industrielle. Les grands patrons se sont lancés dans une compétition sans frein à la rémunération. Que des dirigeants gagnent très bien leur vie n’est pas choquant en soi. Mais que leur rémunération soit totalement disproportionnée par rapport à leur action effective dans l’entreprise pose une véritable question. Surtout lorsque cette action est négative. Le système des parachutes dorés, par exemple, qui permet à un patron de partir avec plusieurs millions d’euros d’indemnités lorsqu’il est révoqué par son conseil d’administration, est très choquant. Il consiste en effet à récompenser grassement un dirigeant qui a échoué, au mépris des grands principes de responsabilité individuelle affichés par l’économie de marché.
Plus subtil, mais plus destructeur est le système des stock-options, qui consiste à attribuer des actions de l’entreprise à ses dirigeants, souvent sous certaines conditions de durée ou d’ancienneté. A la base, l’idée peut paraître intelligente: elle pousse les équipes de direction à faire monter le cours de l’action pour dégager des sommes qui peuvent s’élever à plusieurs millions d’euros, voire au-delà. Si l’on part de l’hypothèse traditionnelle selon laquelle les cours de la bourse reflètent la situation financière de l’entreprise, la méthode est saine.
Le problème est que la bourse est devenue irrationnelle. Elle s’est transformée en une vaste table de poker, où les cours peuvent fluctuer selon des règles imprévisibles. Les stock-options se sont donc transformées en une tyrannie destructrice pour les entreprises elles-mêmes. Pour faire monter les cours, les dirigeants doivent dégager des marges de rentabilité de plus en plus importantes. La dictature des actionnaires dans les entreprises oblige souvent à verser en dividendes l’argent nécessaire à des investissements indispensables. Ces exigences folles sont une menace pour la survie des emplois et des entreprises elles-mêmes, saignées à blanc par leurs propriétaires.
Toutes ces évolutions ont profondément changé le visage de la France de mon enfance. Celle que je vois aujourd’hui me plaît beaucoup moins, et même me met au bord de la nausée. Elle ne porte plus les valeurs qui ont fait sa grandeur: l’engagement au service d’un idéal collectif, la beauté d’un travail qui a du sens, une forme de discrétion et même d’humilité pour faciliter la vie ensemble. Elle est plus âpre, plus avaricieuse. Elle exalte l’agressivité et l’ostentation. Ce qui sert à tous est stigmatisé: la sécurité sociale, l’école, les dépenses publiques, l’impôt. Ce qui sert à l’élite et au paraître est vanté: les montres en or, les vacances de luxe, l’héritage, la rente, le tape-à-l’oeil des grosses voitures, les petits arrangements entre amis ou entre membres d’une même famille pour réussir sans effort. Et surtout, il y a ce sentiment étrange d’être dissident dès lors que l’on n’approuve pas personnellement ces évolutions.
Comme beaucoup de Français, et beaucoup d’énarques, j’ai longtemps cru qu’elles étaient inévitables. Comme le fruit naturel de l’histoire. Le mur de Berlin est tombé, le capitalisme a triomphé. La mondialisation se fait. Une concurrence internationale fait rage. Tout cela ne nous donne pas le choix. Et après tout, nous avons vécu comme des coqs en pâte pendant les Trente Glorieuses. Il est bien normal que tout cela se paie. Cela ne pouvait durer éternellement. Comme tout le monde, j’ai cru à ces litanies.
C’est là qu’intervient le second cercle fermé d’énarques auquel j’appartiens: celui des transfuges vers le secteur privé, les pantoufleurs comme on dit. En octobre 2007, je rejoins une fédération patronale, et j’entame un parcours dans l’univers des entreprises françaises, qui me conduit, en 2009, à la présidence de l’association paritaire pour l’emploi des cadres (APEC), et à de nombreux et prestigieux conseils d’administration: Unedic, Pôle-Emploi, CNAV, AGIRC-ARRCO, etc.
Je suis arrivé dans ce monde avec l’ingénuité du fonctionnaire qui souscrivait sans réserve aux discours de la pensée unique sur l’inefficacité de l’Etat. Je m’imaginais l’entreprise comme un espace de rationalité où tous, comme un seul homme, cherchaient à améliorer les processus de production pour garantir une meilleure efficacité et une productivité optimale. J’avais intériorisé l’idée selon laquelle l’entreprise réussissait tout ce que l’Etat était incapable de faire.
Il ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre combien tout cela était une vue de l’esprit. En réalité, les femmes et les hommes dans les entreprises ont la même nature et la même façon de penser que dans l’administration. Dans le privé comme dans le public, il existe dans des proportions identiques des gens de bonne volonté et des mauvais coucheurs, des gens motivés et des flemmards, des compétents et des incompétents, des caractériels et des gentils, des gens sincères et des imposteurs. A taille égale, les problématiques sont les mêmes. Une grande entreprise a les mêmes difficultés de circulation d’information et de délégation de responsabilité qu’une grande administration. Une petite entreprise a les mêmes difficultés de mobilité de ses personnels qu’une petite administration. Ce fut une leçon de choses intéressante, un premier indice sur la fausseté de mes certitudes acquises à force d’ingurgiter les clichés distillés jour après jour par les médias.
Il me semble qu’assez rapidement j’ai commencé une sorte d’éveil.
En septembre 2008, la crise boursière a bouleversé la vie des entreprises. Quelques affaires de parachutes dorés ont, dans la foulée, secoué l’opinion. Le gouvernement a enjoint au MEDEF de prendre des mesures rapides pour mettre bon ordre à ces provocations sans quoi il légiférerait sur les rémunérations des dirigeants. Laurence Parisot décide de réformer en urgence le code de déontologie MEDEF-AFEP pour clarifier le sujet, notamment en interdisant le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail pour les dirigeants des entreprises cotées sur les marchés. On découvre alors que les dirigeants des grandes entreprises ont trouvé le bon filon. Leur mandat social de dirigeant leur permet de percevoir des rémunérations annuelles de plusieurs millions d’euros. Mais comme ce mandat est révocable du jour au lendemain, ils le cumulent avec un contrat de travail qui leur donne de véritables garanties en cas de rupture inattendue.
Dans mon esprit, c’était une affaire secondaire. D’abord, je n’avais pas bien compris de quoi il s’agissait. Ces choses techniques ne m’intéressent pas et me semblent ennuyeuses. Ensuite, j’ai eu la faiblesse de penser que des gens rémunérés plusieurs millions d’euros par an et occupés à diriger leur entreprise n’ont guère de temps à consacrer à ces choses. Et, à ce moment, ma torpeur s’est dissipée. À chaque visite au MEDEF, je n’entendais plus parler que de cette affaire dans les couloirs. Les grands patrons étaient furieux contre Laurence Parisot, parce qu’elle leur demandait de renoncer à leur contrat de travail. Et ces gens, qui depuis dix ans répétaient urbi et orbi que le droit du travail en France était trop rigide, que le contrat de travail était trop protecteur pour leurs salariés, ces gens, qui avaient mandaté Laurence Parisot pour négocier plus de flexibilité pour le contrat de travail de leurs salariés, devenaient de féroces avocats de leur propre contrat et des droits qu’il leur offrait. Un vent de fronde soufflait. Alors que les entreprises allaient mal, que des charrettes de licenciement étaient annoncées, une seule chose occupait les esprits: la situation juridique des dirigeants.
Tout cela avait un goût de 10 mai 1940. De ces moments où les généraux demandent à la troupe de se sacrifier pour protéger leur fuite, alors même qu’ils sont les seuls responsables de la défaite. Car, soyons bien clairs, la seule cause de la crise de 2008 tient à l’irresponsabilité des élites financières. Si les administrateurs des banques avaient joué leur rôle, notamment en empêchant des stratégies de crédit risqué, si le gouvernement américain, en 1998, sous l’influence des financiers, n’avait pas autorisé la fusion des activités bancaires et d’assurances, alors même que cette fusion était impossible depuis la crise de 1929, si les financiers américains n’avaient pas prêté à tour de bras des sommes colossales à des pauvres gens dont ils savaient qu’ils pourraient difficilement rembourser leurs dettes, si les banquiers européens n’avaient pas été complices de ces pratiques — tout cela visant à tirer des profits usuraires sur la misère humaine — nous n’aurions pas subi la crise des subprimes et l’effondrement de l’économie mondiale comme un château de cartes. Et l’argent des contribuables n’aurait pas été sollicité pour rembourser ces erreurs monumentales.
Durant l’hiver 2008, je n’en étais encore qu’au stade de l’éveil. Grâce à mon appartenance à un troisième cercle d’énarques, j’ai transformé cet éveil en cheminement intérieur. Je présente en effet la particularité plutôt rare, parmi mes camarades, d’être un Français de l’étranger. Je suis né à Liège, la ville francophone la plus septentrionale d’Europe, et c’est là que j’ai grandi, face au monde germanique. À Liège, de la France, on sait tout et on ne sait rien. On fête le 14 Juillet, plutôt que la Fête nationale belge. On se rend à Paris plus volontiers qu’à Bruxelles. On apprend aux enfants qu’en 1789, le peuple liégeois s’est soulevé contre l’oppression autrichienne lorsque la nouvelle de la prise de la Bastille est arrivée. On rappelle que Liège était la préfecture du département de l’Ourthe, lorsque les troupes de la Révolution ont libéré la ville. La France, c’était cela pour moi: le peuple qui s’affranchit de la tyrannie. La liberté qu’on proclame. Un appel d’air victorieux vers la démocratie.
Lorsque j’étais arrivé à Paris, il y a plus de vingt ans, j’avais surtout découvert qu’il existait une aristocratie républicaine, celle des beaux quartiers, des héritiers, des grandes écoles, des cercles fermés où l’on admet que des pairs. Durant l’année 2008, j’ai mesuré le poids effectif, réel, de cette aristocratie dans les décisions, et sa capacité à reporter sur le peuple le prix de ses erreurs. J’ai alors décidé de mesurer l’écart qui sépare la république telle que ses fondateurs l’avaient conçue il y a un peu plus de deux cents ans — la seule que je connaissais, celle qui me fut enseignée dans la monarchie où j’ai grandi — et la république aristocratique que nous connaissons aujourd’hui. J’ai pris du temps et de la distance pour réfléchir. Le travail intérieur que j’ai mené a consisté à revenir aux choses et aux mots, pour tenter de les comprendre. À retrouver le sens d’une tradition dévoyée.
L’essentiel de ce long soliloque s’est concentré sur l’évolution de la pensée politique et économique depuis la crise de 1974. Cette crise a marqué un véritable tournant dans notre conception du gouvernement dans les sociétés industrielles. Elle s’est traduite par une stigmatisation systématique du rôle de l’Etat, sous toutes ses variantes: Etat-Providence, Welfare State, etc. L’économie de marché s’est imposée comme l’alpha et l’oméga de l’ordre social. Il n’est plus possible aujourd’hui de formuler un projet politique qui entraverait le principe sacré de libre concurrence. On peut seulement parler de rationalité économique, de croissance, de mondialisation, de concurrence pure et parfaite, d’orthodoxie monétaire, de maîtrise des finances publiques. Comme beaucoup de Français, j’ai fait confiance au système. Je me suis laissé bercer par ces mots. Mais le moment m’a semblé venu d’ouvrir les yeux et de regarder de plus près à toutes ces certitudes.
Assez vite, j’en suis venu à me poser des questions simples: nous vivons prétendument dans la rationalité, mais la Bourse me parait une sorte de machine à sous totalement aléatoire à laquelle est suspendue l’ensemble de notre vie économique. Nous ne cessons d’élire des gouvernements hostiles au rôle de l’Etat, mais la dette publique est en expansion constante. Nous ne cessons de rechercher la croissance, mais elle ne vient jamais. Nous sommes pour le libre échange et l’économie de marché, mais la mondialisation profite essentiellement à la Chine, qui a une économie administrée.
Tous ces paradoxes, j’ai voulu en venir à bout. Je les examine chapitre par chapitre. Pour ce faire, je me suis presque exclusivement référé à la littérature officielle, notamment celle de l’Insee, du FMI, de la Banque Mondiale, de l’OCDE, et à différents rapports d’autorités administratives indépendantes. Il m’a paru important de ne partir que de données incontestables et qui ont pignon sur rue.
Ma conclusion générale est que, sous couvert de mener de grandes réformes économiques libérales, une aristocratie a dévoyé notre régime démocratique et l’a capté à son profit. Le discours favorable à l’économie de marché a surtout servi à nous subordonner à ces aristocrates, pour qui les citoyens ne sont que des contribuables, des assujettis à l’impôt, comme on dit en finances publiques, ce qui ressemble fort aux sujets de l’Ancien Régime. Cela ne signifie nullement que l’économie de marché est inexorablement vouée à se transformer en système aristocratique. Mieux réglementée, mieux organisée, elle garantirait une prospérité raisonnable à tous. En revanche, les évolutions connues et choisies dans le monde industriel durant les trois dernières décennies sont allées dans un autre sens. Elles ont assis le pouvoir d’une élite financière sur l’ensemble de nos systèmes démocratiques, de telle sorte que cette élite s’enrichit massivement en phase de croissance positive, et fait rembourser ses pertes aux citoyens assujettis en phase de récession.
Collectivement, tout le monde a bien le pressentiment de cette réalité, même si le battage médiatique et politique contribue à maintenir un voile opaque autour de ses aspects les plus choquants. De ce point de vue, les moyens de détourner l’attention des assujettis ne manquent pas. Entre l’incitation à la xénophobie que constitue régulièrement le discours sur l’insécurité, la stratégie de la division où l’on clive une France contre l’autre (celle qui se lève tôt contre celle qui se lève tard; les fonctionnaires contre les salariés du secteur privé; ceux qui partent tôt à la retraite contre les autres, etc.), les grandes manifestations sportives où des psychodrames fabriqués de toutes pièces occupent les esprits, il faut être héroïque pour retrouver son latin.
Malgré toutes ces diversions, je connais peu de Français qui se retrouvent dans le fonctionnement actuel de notre société. Chacun perçoit, même obscurément, que la république de notre enfance n’est plus faite pour tous, qu’elle obéit moins que jamais à des objectifs d’intérêt général. Son sens s’est perdu pour servir d’autres intérêts que ceux du peuple.
C’est précisément contre les risques d’une perception obscure de tout cela qu’il m’a paru indispensable d’écrire ce livre. De toutes parts, même dans des milieux aisés traditionnellement attachés à notre ordre social, j’entends se murmurer un fond de «Tous pourris!» qui est extrêmement dangereux pour la démocratie. Il existe aujourd’hui une montée de l’antiparlementarisme et une désaffection pour la république telle qu’elle est devenue. Ces phénomènes sont inquiétants. Si nous, les démocrates, ne réagissons pas avec vigueur, nous ferons par notre passivité, le lit d’idéologies et de réactions qui nous ont coûté cher par le passé. Sur ce point, je prends date. À ce stade, nous ne sommes pas encore entrés dans le vif de la crise économique survenue en 2008. Pour l’instant, son coût a été financé par la dette. Lorsque l’heure viendra de rembourser cette dette, notre société affrontera un moment de vérité, qui pourrait se révéler très périlleux pour tous. Nous en avons de premiers prémices: l’avenir de la sécurité sociale, des dépenses de l’Etat, comme l’éducation ou la justice, le coût effectif de la décentralisation, seront au coeur de nos débats.
Personne ne sait quelle tournure notre histoire peut prendre à ce moment-là. Pour ma part je souhaite à toute force que triomphent les splendides valeurs qui ont fait la grandeur de la France: la liberté, l’égalité, la fraternité. Leur préservation suppose qu’aujourd’hui nous retrouvions le sens du geste républicain posé il y a un peu plus de deux cents ans par des gens nouveaux qui n’eurent d’autre choix que de secouer un joug irréformable. La France actuelle n’est guère plus malléable qu’à l’époque, et, par un étonnant parallélisme de l’histoire, elle se heurte à une semblable crise des finances publiques.
L’enjeu essentiel pour la conscience républicaine aujourd’hui consiste à retrouver le sens de notre république démocratique, à la remettre au service de tous. Nous ne pourrons nous dispenser d’un vaste mouvement de retour vers ce sens originel, sous peine de laisser libre cours à des forces obscures qui ont fait notre honte il y a quelques décennies. Les quelques pages qui suivent sont une contribution à ce renouement avec le sens de notre destin historique.
Comme toujours dans ces ouvrages, il faut rendre un difficile arbitrage entre l’analyse et l’action, entre l’exemple et la théorie. Je n’ai délibérément pas voulu mener l’un sans l’autre, mais je crois avoir toujours évité les polémiques et les discours de caniveau. Il m’a paru important, pour illustrer mes propos, de donner chaque fois des éléments circonstanciés pour expliquer comme j’en suis arrivé à remettre régulièrement en cause des convictions que j’avais acquises jusque-là. Je n’ai pas voulu donner à ceux-ci un tour accusatoire ou hostile. En revanche, il m’a semblé important de tendre la main à ceux qui, aujourd’hui, n’osent pas forcément avouer leur dissidence avec un système dominé par une chape de plomb idéologique: que ceux-là comprennent que leur parcours fut le mien. Jour après jour, nous engrangeons tous des constats, des réflexions, qui nous conduisent à penser que quelque chose ne tourne pas rond dans nos régimes. Avoir le courage de l’avouer, puis de le dire, ne coule pas de source. Cette étape nous condamne souvent à endosser le regard réprobateur de l’opinion.
Je le redis, ce courage-là est important, à mon sens, pour l’avenir de notre système républicain.
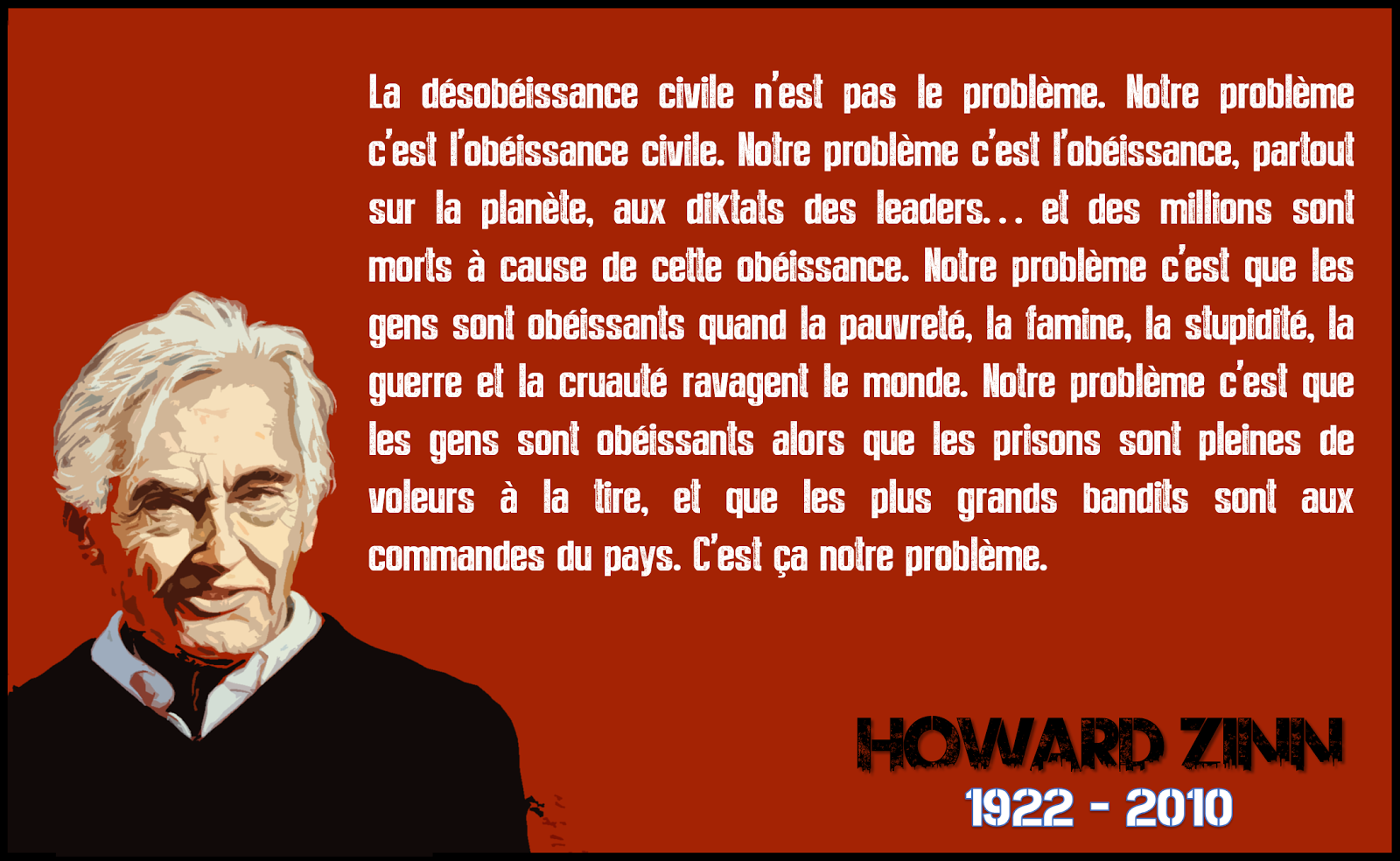
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire